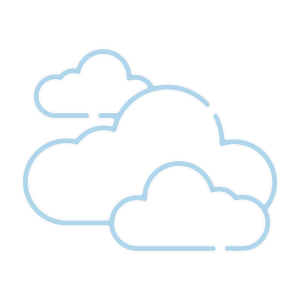Les marées vertes source d’Hydrogène Sulfuré (H2S)
Depuis les années 70, la Bretagne fait face à un phénomène de prolifération saisonnière des algues vertes.
Cette croissance d’algues vertes est favorisée par l’effet de deux principaux facteurs :
- Les nitrates issus des cours d’eau du littoral qui nourrissent les algues en azote ;
- La morphologie de certaines baies, fermées et peu profondes ; les algues prolifèrent ainsi en eau claire et peu renouvelée.
Depuis plus d’une 10aine d’années, les collectivités s’organisent pour ramasser les algues au fur et à mesure de leur échouage sur les plages lorsque cela est techniquement réalisable.
Dans certaines configurations où la collecte n’est pas possible (vasières, rochers), les algues s’accumulent, entrent en décomposition et produisent des gaz toxiques, dont l’hydrogène sulfuré (H2S).
Pour plus d’informations, consultez le site algues vertes de la préfecture de Bretagne
Des campagnes de mesure, au développement du réseau régional de surveillance dès 2022
Air Breizh a réalisé à partir de 2005 des campagnes de mesure ponctuelles de l’hydrogène sulfuré sur plusieurs sites du littoral breton, proche des zones de dépôts et de putréfaction, ainsi qu’autour des sites de traitement des algues vertes.
Ce gaz plus dense que l’air, d’odeur fétide caractéristique d’œuf pourri, a été identifié comme le traceur le plus pertinent pour suivre les nuisances liées à la décomposition des algues vertes.
Depuis 2017, des campagnes d’étude ont été spécifiquement réalisées dans la baie de Saint-Brieuc, zone qui concentre la grande majorité des échouages d’algues vertes dans la région.
Les données de mesures depuis 2017 sont accessibles en suivant ce lien.
Depuis 2022, grâce au soutien financier de l’ARS Bretagne, un réseau de surveillance régionale d’hydrogène sulfuré est déployé sur des sites des baies « Algues vertes » bretonnes identifiées dans le Plan de Lutte contre les Algues Vertes (PLAV), soumises à des phénomènes d’échouage et de putréfaction persistants.
Le dispositif de surveillance régionale – saison 2025
Pour cette nouvelle saison d’échouage 2025, la surveillance est réalisée sur 17 points de mesure, positionnés sur le littoral breton.
Le réseau est activé du 15 mai au 15 octobre sur cette année 2025 ce qui permet de couvrir la majorité de la période d’échouage des algues vertes.
Le déploiement de ce dispositif, la diffusion des résultats des mesures et leur exploitation s’appuient sur les recommandations de l’avis du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) du 10 décembre 2021, complété par un courrier le 14 février 2022 (lien), qui a défini un seuil d’alerte fixé à 1 ppm (partie par million).
Les résultats des mesures, mis à disposition des autorités compétentes, de la population et des acteurs de la santé, participent à l’information du grand public, à la veille sanitaire et à l’adaptation des mesures de gestion de la zone (priorisation des actions sur le terrain, mise en œuvre de mesures spécifiques de protection de la population, …).
Les recommandations sanitaires préconisées par l’Agence Régionale de Santé Bretagne sont disponibles en suivant ce lien : Les algues vertes | Agence régionale de santé Bretagne (sante.fr)
Choix des sites de mesure
Le positionnement des points de mesure est revu chaque année dans le cadre d’une concertation menée entre les préfectures, l’ARS, chacune des collectivités locales concernées et Air Breizh.
La pré-identification des zones sensibles s’est appuyée sur les travaux du CEVA ( rapport ‘Identification des zones de dépôts d’algues à risque en Bretagne’ – CEVA avril 2021 et observations terrain). Ce travail a été recoupé avec des données complémentaires liées à la densité de l’habitat, la fréquentation des secteurs, notamment en période touristique.
La carte ci-dessous permet de visualiser la localisation des 17 points de mesure, répartis au sein des 7 baies concernées par le dispositif.
Source : Carte de localisation des sites de mesure 2025
Diffusion des données
La diffusion des données de mesure se décompose comme suit :
- Rapport hebdomadaire :
Chaque semaine pendant la surveillance, un rapport présentant les résultats des mesures de la semaine passée est mis à disposition sur la présente page. Il synthétise les résultats des mesures disponibles au moment de son édition.
- Accès direct aux données :
Pendant la saison de surveillance, la présente page donne accès aux données quart-horaires et horaires (des 7 derniers jours) et journalières (des 30 derniers jours) sous un délai de 48h. Ce décalage permet d’assurer une validation des données, en prenant notamment en compte d’éventuelles difficultés de communication avec les capteurs.
- Accès à l’historique des mesures :
Un fichier de synthèse des données est actualisé périodiquement durant la surveillance (en début de mois avec les données du mois écoulé). Il reprend les données de mesures depuis 2017.
- Rapport :
Un rapport d’étude est réalisé à l’issue de chaque saison de surveillance et mis en ligne sur notre site internet (rubrique publications).